
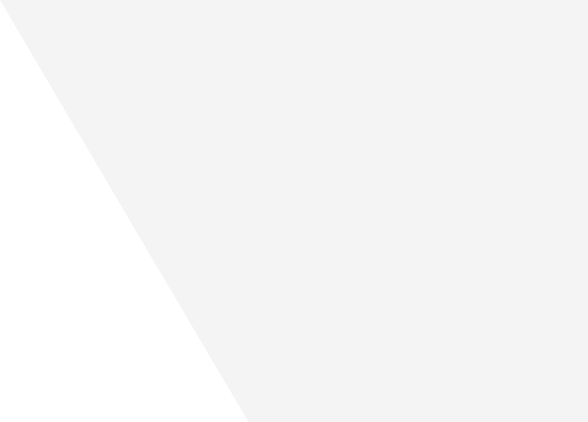
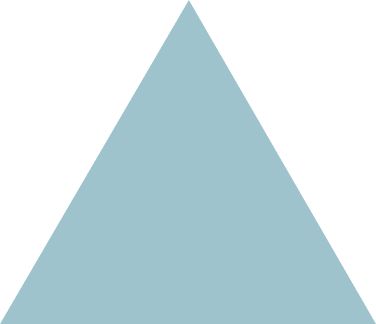

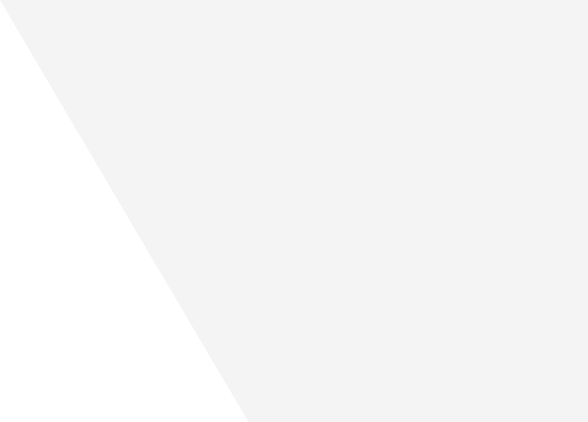
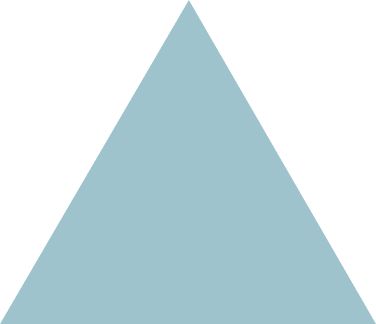
Qualifié de « chantier du siècle » par le Sénat dans son rapport de 2019, la gestion des ponts routiers est un défi de taille pour les collectivités territoriales qui gèrent 90% du parc français.
Face à cet enjeu, gestionnaires et services techniques recherchent les moyens de développer une gestion plus patrimoniale de leurs infrastructures routières.
Voyons quelle méthode peuvent adopter les différents acteurs pour développer une gestion plus proactive et efficace de leurs ponts routiers.
En France, l’entretien et la réparation des ponts est assuré par les gestionnaires des routes tels que l’Etat, les concessions, les départements ou les collectivités territoriales.
Le nombre de ponts routiers gérés par les acteurs publics est estimé entre 200 000 et 250 000.
Selon les estimations du Sénat, plus de 25000 ponts sont jugés en mauvais état, soit :
Source : Rapport du Sénat du 26 juin 2019
C’est donc majoritairement sur les communes françaises et leurs intercommunalités que repose la charge d’entretien des ponts routiers en mauvais état, la plus importante.
Historiquement, faute de stratégie et de moyens, les politiques de maintenance des ouvrages d’art se concentraient davantage sur la résolution immédiate des problèmes plutôt que sur une gestion préventive et programmée.
Cela a pu entraîner plusieurs conséquences négatives.
La gestion purement réactive des ponts routiers peut avoir des conséquences négatives sur les finances des collectivités et peut aussi altérer leur image de bon gestionnaire.
Malgré le souhait des élus de prévenir tout problème lié aux ponts sur leur territoire, lorsqu’un pont se détériore et que les coûts de réparation ne sont pas prévus dans le budget, cela aura un impact immédiat sur les finances publiques.
La gestion de la collectivité peut aussi être critiquée par les autorités de tutelle, l’opposition locale ou les citoyens.
Les experts sont conscients que l’entretien régulier des infrastructures est beaucoup moins coûteux que de les laisser se dégrader et devoir les réparer plus tard.
De plus, si les moyens pour l’entretien sont insuffisants, il y aura de plus en plus de restrictions de circulation et même des fermetures de voies, ce qui nuit au final à l’économie locale et à l’attractivité des territoires.
Enfin du point de vue de la sécurité, bien que rares, les incidents mortels tels que celui survenu sur le Pont de Gênes en 2018 ont laissé une forte impression et sont considérés comme inacceptables par la population.
Aborder le sujet du pont routier conduit les collectivités à se confronter à plusieurs problématiques complexes.
La maitrise et la connaissance du patrimoine dont les ponts routiers font partie , est un sujet sensible pour les collectivités.
Le sujet est nouveau car auparavant c’était la Direction Départementale de l’Equipement qui s’occupait des routes et des ponts.
Les collectivités ont récupéré la gestion de ces objets dont ils n’ont pas la connaissance et si l’inventaire se complète progressivement , il est encore loin d’être exhaustif.
En tant que gestionnaire, il appartient à la la collectivité de garantir l’état de ses ponts routiers.
La question est d’autant plus épineuse pour les ponts anciens : comment évaluer leur vétusté et les risques associés.
Les usagers peuvent-ils encore l’emprunter en toute sécurité ?
Si les risques sont présents, quelles sont les actions à mener pour pérenniser les ponts qui posent problème.
Quels sont ceux à traiter en priorité ?
Enfin dans un budget contraint, comment prioriser pour utiliser au mieux les finances publiques pour réparer et entretenir les ouvrages présents sur le territoire de la collectivité.
L’idée principale est d’utiliser une méthodologie d’analyse de risques, croisée avec les enjeux
Pour réaliser ce diagnostic, plusieurs sources d’information sont à considérer :
Les données collectées permettent alors d’établir un diagnostic en 3 étapes :
Il s’agira de déterminer quels sont les types d’usage :
Après avoir répertorié tous les ponts routiers dont la collectivité a la responsabilité, il s’agit de qualifier les conséquences que pourraient provoquer leur défaillance potentielle selon leur état et l’enjeu qu’ils représentent.
Réalisé à partir d’interviews et de modèles de données, cet inventaire des risques permet ainsi de classer les ponts selon la gravité des impacts propres à chacun.
Les ponts sont identifiés selon leur état technique à l’aide de l’échelle suivante :
La prise en compte du volume de trafic et des types d’usage du pont permettent de déterminer l’enjeu que représenterait une défaillance selon l’échelle suivante :
A partir de ces données, une cartographie des ponts croisant gravité des risques et état peut alors voir le jour.
Quatre groupes représentant un risque plus ou moins important peuvent alors être définis :
Des modèles prédictifs basées sur les lois de vieillissement permettent ainsi de créer une cartographie des ponts et de la projeter dans le temp. Les besoins, les actions et les budgets permettant de les entretenir et de les maintenir en bon état, sont donc clairement établis pour les prochaines années.
Ces modèles permettent donc de créer une base de connaissance claire qui facilite la prise de décision et la prévision budgétaire.
Les opérationnels peuvent ainsi mieux argumenter leurs projets de rénovation auprès des élus pour obtenir les budgets d’investissements dont ils ont besoin.
Toutes les données collectées doivent être centralisées et digitalisées dans un référentiel unique.
C’est ainsi que chaque collectivité pourra gérer son patrimoine d’infrastructures de manière claire, précise et dynamique pour répondre aux enjeux opérationnels.
Oxand met à disposition de ses clients une méthodologie unique basée sur des modèles prédictifs afin de garantir une gestion proactive et efficace des ponts routiers et des infrastructures.
Pour aller plus loin, un dispositif est proposé en partenariat avec la Banque des Territoires.
PrioRéno Ponts est un dispositif numérique gratuit qui permet de prioriser les études concernant les ponts potentiellement les plus en risque. Il offre aux collectivités un éclairage sur l’état de leur parc et son évolution si aucun investissement de rénovation n’est réalisé. Contactez votre direction régionale de la Banque des Territoires pour en savoir plus.
> Retour aux actualités